![]() Vendredi 13 Décembre 2019
Vendredi 13 Décembre 2019
Bonjour… ![]() Xin Chào…
Xin Chào…
Ce Vendredi 13 sera-t-il un jour de chance ? même
en scrutant, je n’aperçois pas d’officines qui auraient pu vendre le ticket
gagnant ![]() !
aussi je rejoins Than qui va nous mener dans un village perdu au cœur de la
campagne cambodgienne, mais auparavant nous ferons une halte pour découvrir en
pleine campagne un champ de lotus, où poussent d’innombrables fleurs roses.
!
aussi je rejoins Than qui va nous mener dans un village perdu au cœur de la
campagne cambodgienne, mais auparavant nous ferons une halte pour découvrir en
pleine campagne un champ de lotus, où poussent d’innombrables fleurs roses.
 J’aperçois beaucoup
de bixi-taxis dans les rues de Phnom Penh, moyen de transport que je n’ai pas vu
au Vietnam. A présent la route est bordée de rizières, de plantations d’anacardiers,
vous savez l’arbre qui donne ces fameuses noix de cajou qu’on aime tant
J’aperçois beaucoup
de bixi-taxis dans les rues de Phnom Penh, moyen de transport que je n’ai pas vu
au Vietnam. A présent la route est bordée de rizières, de plantations d’anacardiers,
vous savez l’arbre qui donne ces fameuses noix de cajou qu’on aime tant ![]() !
!
 Sur le bord de la
route, de sommaires stands proposent du sucre dans un tube, tuyau qui n’est ni
plus ni moins qu’un bout de canne à sucre.
Sur le bord de la
route, de sommaires stands proposent du sucre dans un tube, tuyau qui n’est ni
plus ni moins qu’un bout de canne à sucre.
A la différence du nénuphar dont la fleur flotte sur l’eau, celle du lotus pousse au bout d’une longue tige, un fait rare parmi les fleurs aquatiques. Dans ce langage, celle-ci représente la pureté et l’accomplissement personnel. Lorsqu’elle est en bouton, la fleur est vendue dans les marchés. Les pétales se plient, les graines et la racine se mangent, quant à la tige, les fils qu’elle contient pourront servir à faire des écharpes, travail effectué aujourd’hui dans les usines textiles, autrefois il y avait dans la capitale pas moins de 90 tisserands.
La fleur de lotus a quelque chose qui relève du sacré depuis la nuit des temps. Dans les religions orientales telles que le bouddhisme et le brahmaïsme, le lotus a toujours été un symbole divin, associé aux dieux Vishnu et Brahma. Lorsqu’il est assis, le Bouddha est représenté assis sur cette fleur, il est dit que lorsque ce dernier marchait, les fleurs de lotus s’épanouissaient sous ses pas.


![]()
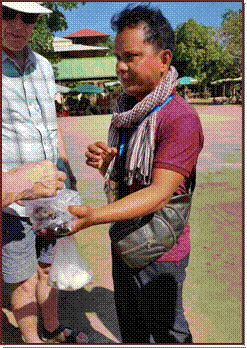
Le prochain arrêt
est pour un marché qui est, il faut bien le dire, un peu spécial, sur notre gauche
j’aperçois de traditionnels commerces de fruits et légumes, mais Bunthorn se
dirige vers la droite, là où à son avis, c’est certainement plus intéressant.

Hé oui, vous l’avez compris, nous allons goûter à des vers grillés, des crickets…
Si, si ! Bunthorn qui en a acheté nous propose de les « déguster » ![]() !
!
Des gamins nous
courent après et posent sans préambule leurs mygales vivantes sur nos
tee-shirts, voir notre effroi les font rigoler. Sur la place, des fillettes
nous harcèlent pour tenter de nous vendre quelques bananes, il est vrai que ce
n’est pas cher : 3000 reals les 6 (0,70€)
A la suite de Bunthorn nous déambulons dans ce marché ou des femmes proposent sur
des plateaux ou dans des marmites en inox posés sur des tabourets ou des
cagettes : sauterelles, crickets, scorpions, vers, grenouilles, cailles, etc…



 Quelques stands proposent
des fruits séchés : bananes entières ou en rondelles, figues, mais aussi
cacahuètes, amandes, pistaches, noix de cajou, bien tentant tout ça !
mais en ramener augmenterait le poids de ma valise d’autant que chaque paquet
doit bien peser un kilo, concevable encore au début du voyage pour en croquer
de temps à autre, mais plus possible à moins de trois jours de prendre l’avion,
dommage !!!!
Quelques stands proposent
des fruits séchés : bananes entières ou en rondelles, figues, mais aussi
cacahuètes, amandes, pistaches, noix de cajou, bien tentant tout ça !
mais en ramener augmenterait le poids de ma valise d’autant que chaque paquet
doit bien peser un kilo, concevable encore au début du voyage pour en croquer
de temps à autre, mais plus possible à moins de trois jours de prendre l’avion,
dommage !!!! ![]()
 Il y a un peu de
route avant d’arriver au village, j’aperçois parfois devant les maisons un
rectangle doré, c’est la récolte de riz qui est ainsi mise à sécher.
Il y a un peu de
route avant d’arriver au village, j’aperçois parfois devant les maisons un
rectangle doré, c’est la récolte de riz qui est ainsi mise à sécher.
Bunthorn, après nous avoir offert de la patate douce et de la banane séchées, nous fait un cours de savoir vivre : comment on doit dire bonjour, selon qu’on s’adresse à une femme, à un homme, ou à une personne plus âgée que soi.
Au Cambodge, la politesse est régie par des traditions séculaires de respect et de hiérarchie. La manière traditionnelle de se saluer est de joindre ses mains avec les paumes se touchant, et incliner la tête.
 Ce geste s’appelle
le Sampeah, plus le Sampeah est élevé, plus on montre son respect.
C’est ainsi que pour accueillir des personnes du même âge ou de la même
position sociale, il faut joindre ses mains devant sa poitrine, pour saluer
son patron, les personnes âgées, le Sampeah doit être positionné de
sorte que les doigts soient juste en-dessous de la bouche. Les parents et les
enseignants sont accueillis avec le Sampeah au niveau du nez, ceux au
niveau du front sont exclusivement destinés à la prière, aux sites sacrés et au
culte du temple.
Ce geste s’appelle
le Sampeah, plus le Sampeah est élevé, plus on montre son respect.
C’est ainsi que pour accueillir des personnes du même âge ou de la même
position sociale, il faut joindre ses mains devant sa poitrine, pour saluer
son patron, les personnes âgées, le Sampeah doit être positionné de
sorte que les doigts soient juste en-dessous de la bouche. Les parents et les
enseignants sont accueillis avec le Sampeah au niveau du nez, ceux au
niveau du front sont exclusivement destinés à la prière, aux sites sacrés et au
culte du temple.
Pour nous occidentaux, il y a de quoi s’y perdre, mais
bon, tant qu’on ne salue pas la réceptionniste de l’hôtel ou la serveuse du
restaurant, comme si on s’adressait à un moine ! ![]() oh là, là !
oh là, là !
 Pour occuper le
temps, Bunthorn nous montre comment enrouler, autour de la tête, ce qui peut
nous paraître une simple écharpe. Celle-ci, nommée Krama est un symbole, un
élément du costume traditionnel cambodgien, tout habitant qu’il soit de sang
royal ou simple paysan se doit de la porter tous les jours.
Pour occuper le
temps, Bunthorn nous montre comment enrouler, autour de la tête, ce qui peut
nous paraître une simple écharpe. Celle-ci, nommée Krama est un symbole, un
élément du costume traditionnel cambodgien, tout habitant qu’il soit de sang
royal ou simple paysan se doit de la porter tous les jours.
Ce foulard en coton ou en soie peut être utilisé de multiples manières, attaché sur le crâne à la façon des maharadjahs, ou encore plié sur la tête pour permettre aux femmes qui marchent sur la route, à la fois de se protéger la nuque, mais aussi d’y poser des paniers remplis de bananes, ou encore attaché sur le ventre pour transporter le bébé. Les hommes dans les campagnes s’en servent à la place de culottes, de slips, le conducteur de la moto va, s’il tombe en panne, pouvoir s’en servir comme tapis, on peut aussi s’en faire une chemise en attachant les pans derrière.
« Quand j’étais enfant et que j’accompagnais mes parents aux champs, je les voyais mettre le riz mouillé dans le krama, puis poser celui-ci dans un trou creusé dans la terre, ils allumaient un feu au-dessus, ainsi le riz cuisait à la vapeur. »
Puis il nous parle de la guerre civile, conflit qui se
déroula à la fin du 20ème siècle, opposant les « Kmers
rouges » alliés à la République démocratique du Nord du Vietnam à
celles de l’armée gouvernementale de Norodom Sihanouk, soutenue par les
Etats-Unis et la République du Sud-Vietnam. Il nous confie aussi qu’à
l’accession au pouvoir de la République Kmère, plus de 2000 enseignants furent
emprisonnés, simplement parce qu’ils apprenaient une langue étrangère aux enfants,
quant aux moines, ils n’avaient plus le droit d'utiliser leur pagne, ils
devaient se revouvrir d'une chemise et d'un pantalon noir. Ce fut une époque
bien triste dans ces contrées.![]()
« Au Cambodge, quoiqu’on n’oublie pas l’argent local, le dollar est utilisé partout. En 1993, les casques bleus arrivèrent, leurs salaires étaient versés en dollars et comme il n’y avait alors pas de bureaux de change, ils utilisèrent le dollar, suivis en cela par la population, et ce encore aujourd’hui »
Parlons mariage ! Autrefois au Cambodge le mariage était arrangé, les filles n’avaient pas le droit de sortir seules, les jeunes ne se connaissaient pas. Aujourd’hui modernité oblige, le garçon téléphone à une fille, lui donne rendez-vous et s’ils se plaisent, décident de se marier. Mais les jeunes ne vivent pas ensemble avant le mariage. Le garçon vient alors dans la famille de sa future femme, il va travailler deux ou trois ans dans les rizières, les jardins potagers, faire voir ce dont il est capable, et espérer être jugé apte à se marier avec leur fille.
Lors de la cérémonie qui dure deux jours, ce sont uniquement les parents de la jeune fille qui règlent les frais, les parents du garçon se contentant d’amener des sacs de riz, de légumes, des régimes de bananes, de fruits. Pendant le régime kmer les mariages avaient lieu à dates fixés par le chef du village, parfois plusieurs couples s’unissaient dans la même journée, aucune festivité ne suivait. Pour choisir la date du mariage, on consulte encore de nos jours un astrologue, qui étudie les différents signes du zodiaque. On va inviter jusqu’à 1000 personnes pour célébrer celui-ci, les participants offrent de l’argent en cadeau aux jeunes mariés.
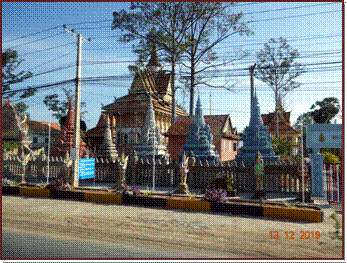 Sujet moins drôle,
mais néanmoins réaliste : le culte des morts. On garde le corps, qu’on a
pris soin d’embaumer, à la maison, le temps que les enfants qui vivent dans une
autre province arrivent. Puis celui-ci est conduit au crématorium, ses cendres
sont entreposées dans un stupa, chaque famille kmer a son propre stupa, parfois
plusieurs sont construits côte à côte, dans l’enceinte d’un monastère, sinon
lorsque la famille est trop pauvre pour avoir son stupa, les cendres sont
jetées dans l’eau de la rivière. Pendant l’époque kmère, les crémations étaient
interdites, ces derniers interdisant toutes pratiques de religion, les cadavres
étaient alors enterrés. Ci-contre, vente de stupas sur le bord de la route.
Sujet moins drôle,
mais néanmoins réaliste : le culte des morts. On garde le corps, qu’on a
pris soin d’embaumer, à la maison, le temps que les enfants qui vivent dans une
autre province arrivent. Puis celui-ci est conduit au crématorium, ses cendres
sont entreposées dans un stupa, chaque famille kmer a son propre stupa, parfois
plusieurs sont construits côte à côte, dans l’enceinte d’un monastère, sinon
lorsque la famille est trop pauvre pour avoir son stupa, les cendres sont
jetées dans l’eau de la rivière. Pendant l’époque kmère, les crémations étaient
interdites, ces derniers interdisant toutes pratiques de religion, les cadavres
étaient alors enterrés. Ci-contre, vente de stupas sur le bord de la route.
Nous voici arrivés à proximité du village de Vaghahisi « Vous allez pouvoir voir quelques enfants, car au Cambodge n’ayant pas de cantine, les enfants sont toujours là pour le repas, certains vont à l’école le matin, pendant que d’autres iront l’après-midi »
Je vous invite à continuer, découvrir ensemble, ce sympathique village cambodgien.
A tout de suite ![]()
![]()
